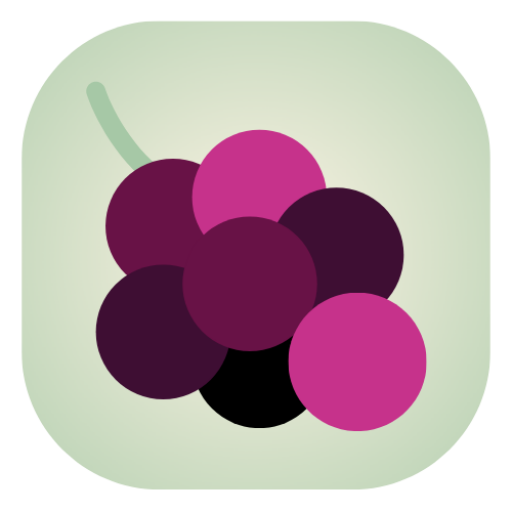Anne-Laure Meynckens est formatrice-consultante sur la question animale.
Juriste de formation (Master en Sciences juridiques, politiques et économiques), elle a exercé pendant 10 ans en tant qu’inspectrice de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes pour le Ministère de l’Économie, un métier qui nécessite approche systémique et adaptation permanente.
Sensible à la cause animale depuis toujours, elle a monté en 2017 le projet Animal360, pour lequel elle a co-réalisé plus de vingt reportages auprès d’associations de protection animale dans une vingtaine de pays, ainsi que plus de trois-cents actions de sensibilisation auprès d’un public varié.
Titulaire de diplômes relatifs à la question animale, elle a créé Drôle De Zèbre en 2020, une agence qui accompagne les collectivités territoriales à développer leurs politiques en faveur des animaux (par la formation et les missions de conseils).
Formatrice certifiée, elle est également enseignante à l’Université de Rennes, dans le Diplôme Universitaire Animaux et société.
Elle est également vice-présidente de l’association Éducation Éthique Animale, et réalise régulièrement des ateliers à destination du jeune public. Elle a initié et co-pilote depuis 2021 la Fresque Des Animaux.
Elle a également co-fondé avec Charlotte Arnal l’Agence Symbiocène, une agence conseil en éthique animale pour les entreprises.

Comment définis-tu le bien-être animal dans une société qui considère les animaux à la fois comme des compagnons, des ressources et des nuisibles ?
Les animaux sont effectivement catégorisés de façon arbitraire par les humains en fonction des relations que nous avons avec eux, et de l’utilité (ou non) qu’ils peuvent en tirer.
Si les attentes sociétales sont de plus en plus grandes quant au bien-être animal, ce vocabulaire est utilisé aujourd’hui seulement pour les animaux qui vivent sous notre dépendance, c’est-à-dire les animaux que nous avons domestiqués pour l’élevage, notre compagnie, l’expérimentation et les animaux sauvages captifs des zoos et des cirques. Pour les ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, terminologie qui a officiellement remplacé le terme “nuisibles” depuis 2016) et les autres animaux sauvages libres, la question de leur bien-être n’est pas posée de la même façon que pour les animaux d’élevage en abattoir : ils sont exclus de cette dimension. Le bien-être animal, qui revêt une réalité bien précise, est malheureusement aujourd’hui une notion relativement galvaudée, utilisée par le milieu de l’exploitation animale et garantie de bonne conscience.
Concernant sa définition, j’ai pour habitude de me référer à celle donnée en 2018 par l’ANSES (voir l’avis de l’ANSES ici), rigoureuse scientifiquement :
“Le bien-être d’un animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal.”
Ce qui est important dans cette définition, c’est qu’elle dépasse le principe des cinq libertés définies par le rapport Brambell en 1965 et reprises par l’OMSA. Ces cinq libertés assurent certes une bonne santé et l’absence de stress et d’inconfort mais elles sont juste un socle du bien-être animal, elles n’en sont pas une définition (contrairement à ce que l’on peut souvent lire).
Ces cinq libertés sont :
– ne pas souffrir de la faim et de la soif
– ne pas souffrir d’inconfort
– ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies
– ne pas éprouver de peur ou de détresse
– pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce
Dans les définitions contemporaines, le bien-être animal intègre, et c’est essentiel, le point de vue de l’animal : ce qu’il ressent en tant qu’individu sensible placé dans un environnement particulier, et ses attentes.
Il est donc important de connaître les besoins d’une espèce mais il est également essentiel de prendre en compte la personnalité des individus et leur histoire propre, pour évaluer si la situation produit des émotions positives ou non.
Pour les animaux exclus de ces préoccupations, le bien-être pourrait commencer par les laisser jouir librement de leur vie.
Quels liens peut-on faire entre la domination des humains sur les animaux et des concepts de domination plus large comme le patriarcat, le colonialisme, etc. ?
La domination des humains sur les autres animaux se manifeste par un traitement inéquitable des individus d’autres espèces que la nôtre sur la base de critères arbitraires moralement et scientifiquement intenables. Le spécisme est un terme construit par analogie avec d’autres discriminations comme le sexisme, le racisme, le colonialisme ou encore le validisme parce qu’elles partagent certains mécanismes de fonctionnement et veulent dénoncer l’oppression subie.
Les rôles de dominants et dominés sont distribués et entretenus par les premiers, qui justifient de pouvoir “naturellement” maltraiter les seconds. Les groupes de « race », de sexe, d’orientation sexuelle ou d’espèce sont des constructions sociales structurées autour de rapports de pouvoir dans lesquels les individus mis à l’écart, hors du groupe de référence auto proclamé, subissent l’oppression des membres de ce groupe.
L’altérisation découlant de la catégorisation, l’infériorisation, la déshumanisation et la réification sont les processus à l’œuvre qui permettent la stigmatisation et la marginalisation de certains groupes qui subissent inégalités et violences.
Ces oppressions sur les individus marginalisés relèvent d’un système de domination, et cela est relevé depuis un moment par de nombreuses personnalités comme Séverine, Louise Michel, Angela Davis, Carol J. Adams, Kaoutar Harchi, Sunaura Taylor, Axelle Playoust-Braure, Florence Dellerie…
Des études montrent des liens entre les discriminations sexistes, racistes et spécistes, même si chacune a sa propre cohérence interne. Les personnes qui expriment des opinions spécistes sont aussi celles qui adhèrent le plus à des positionnements racistes et sexistes1.
Il en résulte que la lutte contre les discriminations faites à certaines catégories d’humains impliquerait logiquement une plus grande considération morale des autres animaux, car cela s’inscrit dans un mouvement de justice sociale global.
Malheureusement, il reste encore aujourd’hui de nombreux cloisonnements entre les luttes. L’idée n’est pas individuellement de lutter sur tous les fronts (c’est souvent impossible puisque les journées ne font que 24h), mais de s’informer sur les oppressions systémiques pour éviter de banaliser ou renforcer des injustices en luttant contre d’autres. L’association Magma propose par exemple une formation sur le lien entre les oppressions, je recommande !
Penses-tu que l’écologie dominante reste trop anthropocentrée à l’heure où de plus en plus de citoyens questionnent la relation des humains avec les animaux ?
Dans les discours écologistes, les animaux en tant qu’individus ayant intérêt à vivre et ne pas souffrir, sont souvent absents, invisibilisés. En écologie, on parle de biodiversité, d’écosystèmes, d’espèces, de fonctions utiles pour les humains. Ce discours jouant sur l’anthropocentrisme est socialement et politiquement plus entendable car il place les humains au cœur des préoccupations : cela flatte notre ego. Il évite ainsi des remises en cause plus profondes de nos modes de consommation et de nos relations aux animaux, c’est donc moins dérangeant.
Aujourd’hui, on ne peut plus ignorer la capacité à souffrir des animaux, grâce aux avancées scientifiques. Cela étant, elle est rarement invoquée par les écologistes pour dénoncer les pratiques qui génèrent des souffrances. Le système d’exploitation animale actuel est validé par une grande partie des mouvements écologistes (cf. le “Comté Gate” récent) et même si les conséquences de la pêche et de l’élevage intensifs sont dénoncées, elles le sont davantage pour des atteintes à l’environnement que pour les animaux eux-mêmes.
Néanmoins, certains mouvements écologistes sentientistes s’intéressent à la question animale en tant que telle. Il existe d’ailleurs une commission condition animale au parti des écologistes. Le travail pour une plus grande justice sociale se veut alors inclusif des animaux dont les intérêts sont pris en compte. Il y a là un décentrement qui permet de s’émanciper d’objectifs exclusivement anthropocentrés et donc spécistes. D’autres partis écologistes comme la REV dénoncent les différentes formes d’exploitation animale.
Les personnes soucieuses des animaux sont également concernées par le bon état des milieux de vie de ces animaux afin qu’ils puissent s’y épanouir, elles sont en conséquence de facto écologistes.
Il est crucial, pour que le projet écologiste de justice sociale aboutisse, qu’une convergence des luttes inclusive de la question animale se développe car il s’agit toujours de rapports de domination.
Les mouvements écologiste et animaliste en sortiraient plus forts. Cela va prendre du temps car notre système économique est basé sur l’exploitation animale et plus précisément sur le complexe animal-industriel, cela suppose donc une remise en cause profonde et systémique.
A ton avis, pourquoi les personnes sensibles à la cause environnementale continuent-elles de consommer des produits d’origine animale ?
De façon générale, les écologistes dénoncent la surexploitation des milieux et des animaux dans sa forme industrielle, mais valident une exploitation qui serait plus acceptable socialement en la présentant comme plus éthique et plus respectueuse de l’environnement. Scientifiquement, il n’en est rien. Que ce soit la pêche ou l’élevage, les impacts environnementaux de méthodes artisanales sont minimisés voire invisibilisés. Cette représentation erronée renforce la légitimité à se nourrir de produits d’origine animale.
De plus, la tradition de la nourriture carnée est naturalisée, présentée comme normale et nécessaire. Là encore, il n’en est rien du point de vue nutritionnel cette fois, il n’y a pas de nécessité à se nourrir de protéines animales. Une récente méta- analyse rendue publique par l’ANSES2 (qu’on ne peut pas taxer de faire le lit des animalistes), révèle que les régimes végétariens voire végétaliens bien menés ne sont pas mauvais pour la santé, et seraient même meilleurs concernant le risque de diabète de type 2.
Albert Moukheiber, docteur en neurosciences et psychologue clinicien, fait souvent appel au concept de cognition incarnée pour expliquer des tendances comportementales. Ainsi, il explique que l’adoption de comportements vertueux peut être freinée par le fonctionnement interne de notre cerveau, et notamment les biais cognitifs, qui sont souvent mis en avant : la dissonance cognitive est la plus fréquente. Elle consiste en des choix contradictoires avec nos convictions morales, nous plaçant dans une tension que nous résolvons soit en mettant notre comportement en adéquation avec nos valeurs, soit en minimisant les conséquences de nos actes, nous mentant à nous-mêmes. Une autre opération mentale est la licence morale. Un individu justifie une action immorale par une autre éthique qui contrebalancerait l’effet de la première.D’autres comme la réactance et l’aversion aux pertes sont aussi décrites mais sans doute ces mécanismes psychologiques font davantage écho à une posture spéciste initiale.
Ces biais cognitifs peuvent en partie expliquer que les arguments rationnels échouent parfois à convaincre, mais Albert Moukheiber indique que “nous ne sommes pas juste notre cerveau, nous sommes un cerveau dans un corps dans un contexte, et ces 3 éléments sont dans une interaction et des boucles de rétroactions permanentes. Prétendre qu’une “nature humaine” désincarnée et décontextualisée existe c’est l’amputer de 2 des 3 facteurs qui la composent.”3
Ainsi, le contexte social est également fondamental dans les freins à végétaliser notre assiette : abandonner la consommation de viande et plus généralement des produits d’origine animale remet en cause des traditions, des habitudes individuelles et collectives et des représentations bien ancrées, et expose à une marginalisation sociale (justification systématique de ses choix de nourriture, exposition à des débats non consentis, exclusion de groupes sociaux).
L’ignorance sincère peut également toucher des individus altruistes non spécistes et qui sont loin d’imaginer les ordres de grandeur (3,2 millions d’animaux terrestres abattus chaque jour seulement en France !), les conditions de vie et de mort de la plupart des animaux notamment d’élevage, pour lesquels nombre de groupes d’intérêt privés et d’institutions perpétuent la banalisation et la normalisation et son cortège de violences et de souffrances.
L’image des animaux dans les publicités ou la pop culture (dessins animés, pubs, films…) est-elle un frein pour la cause animale ?
Il est vrai que les livres, les films et les publicités participent à nos constructions mentales et à notre manière de considérer les autres animaux. Là encore, les catégories d’animaux ne sont pas présentées de la même façon et cela renforce l’arbitraire de l’iniquité de traitement qu’ils subissent.
Dans le cinéma, certains films comme Les dents de la mer véhiculent un spécisme important alors que d’autres suscitent au contraire une réflexion sur la condition animale. C’est le cas de Babe, Okja ou encore Ferdinand.
De la même façon que le test Bechdel, qui indique le niveau de sexisme d’un film, il existe le test SIMBA, proposé par l’autrice Fanny Vaucher4, qui indique le niveau de spécisme d’un film, en se référant à 5 axes : Stéréotype – Individualité – «Mémoire de poisson rouge» – Banalisation – Animaux réels. Vous pouvez le tester sur le prochain film que vous visionnez, vous pouvez être surpris·e.
Parfois, le film peut contrevenir à l’objectif visé. Dans le film Cheval de guerre de Steven Spielberg, dénonçant le terrible sort des chevaux enrôlés dans la guerre, certains chevaux sont morts sur le tournage.
L’imagerie et les slogans publicitaires concernent surtout les produits de consommation alimentaires dont on vante les bienfaits pour la santé. Le marketing est très ingénieux pour dissimuler et travestir la réalité de l’élevage et de la mise à mort des animaux. Le cochon présenté en devanture de charcuterie comme heureux d’être en morceaux (faisant partie des techniques de marketing nommées “suicide food”5 ou le fromage résultant de la tendresse de la mère pour son chevreau en sont des exemples flagrants. Par des éléments de langage efficaces, on fait croire aux consommateurs que le bien-être animal est au cœur des préoccupations des élevages même intensifs.
Quant aux livres, c’est un peu différent. Les animaux sont très présents dans la littérature de jeunesse et depuis quelques décennies, certains ouvrages se placent du point de vue des animaux. Les connaissances foisonnantes en éthologie permettent ce décentrement et ouvrent la voie à une meilleure compréhension du monde tel que l’appréhendent les animaux. Cela permet de dévoiler les nombreuses similitudes entre les humains et les autres espèces et de réfléchir à nos relations avec les animaux quels qu’ils soient. Il existe même des éditions françaises qui sont spécialisées sur le sujet, les éditions Evalou6.
Que réponds-tu aux gens qui opposent bien-être animal et urgence climatique, hiérarchisant ainsi les luttes ?
C’était une critique récurrente adressée aux animalistes par leurs détracteurs, mais qui prend beaucoup de recul depuis quelques années.
L’engagement en faveur des animaux a progressivement gagné en légitimité et en crédibilité dans les sphères privée et publique, et je le vois de très près avec mon métier, lorsque j’interviens pour des collectivités territoriales par exemple. L’existence même de mon métier, et sa viabilité économique, en est une preuve au quotidien.
Opposer l’engagement en faveur des animaux à la lutte contre le réchauffement climatique ou à l’action humanitaire, comme si ces luttes étaient incompatibles, n’a rien de pertinent. On peut à la fois travailler à faire évoluer la condition animale et donner de son temps pour d’autres luttes, comme celle contre le réchauffement climatique.
Par ailleurs, cette remarque vient souvent de personnes qui ignorent les engagements de la personne en face et qui elles-mêmes n’ont pas d’engagement…
Sur le fond, je répondrais qu’il est vraiment important d’adopter une vision systémique des luttes en faveur de justice sociale, pour ne pas discréditer les partenaires de luttes, toutes liées à un mécanisme de domination, et de dézoomer de sa cause. Quand on est sensible à un sujet, on a d’ailleurs tendance (et notre société nous pousse à cela) à se concentrer sur lui, et ne pas nécessairement investir les autres champs connexes. Cela freine une compréhension des liens, des convergences et des quelques divergences des sujets.
Cette représentation pauvre, en silos, bénéficie aux structures économiques dominantes, notamment celles qui dépendent du complexe animal-industriel (agro-industrie, grande distribution, laboratoires, fast-food, etc.) car si les mouvements écologistes et animalistes se méfient ou s’ignorent, ils ne construisent pas de stratégie commune, et ne pèsent pas ensemble sur les politiques publiques ou les modèles économiques. De plus, cela empêche de voir les racines communes des crises actuelles : extractivisme, capitalisme productiviste, domination des animaux et des groupes humains marginalisés.
Une vision systémique permet pourtant de comprendre l’imbrication des causes. Par exemple, l’industrie de la viande implique à la fois : souffrance animale, émissions de gaz à effet de serre, pollution des sols, déforestation, accaparement des terres, forte consommation d’eau et d’antibiotiques, travail précaire, lobbying politique, subventions étatiques massives. Il y a quelques années, des chercheuses et chercheurs ont d’ailleurs alerté sur cette vision en silo au sein de la lutte contre le réchauffement climatique, en dénonçant les effets négatifs d’une “carbon tunnel vision”7, une vision focalisant sur les émissions de gaz à effet de serre.
La convergence des luttes est ainsi un cadre conceptuel fondamental dans les approches militantes, tout en ayant des stratégies diversifiées sur le terrain, tant dans les sujets (lutte contre le réchauffement climatique, le sexisme, le racisme, le spécisme, le validisme, l’homophobie etc.) que dans les degrés de radicalité.
Enfin, je demanderais à ces personnes qui opposent bien-être animal et urgence climatique, dans l’idée de privilégier cette dernière, quelles sont les raisons qui les poussent à lutter contre le réchauffement climatique. On entend parfois des slogans indiquant l’urgence à “sauver la planète”. En réalité, ce n’est pas la planète qui est à sauver, mais ses conditions d’habitabilité. Pour qui ? Pas seulement pour les humains (je rappelle que les humains ne peuvent vivre sans l’existence des autres animaux, ne serait-ce que les pollinisateurs), mais évidemment pour les autres individus qui ont intérêt à vivre, les autres animaux.
Aujourd’hui, la période est inédite : une seule espèce parmi des millions menace l’existence de toutes les autres. La question de notre responsabilité est vertigineuse, et il est grand temps de s’y confronter, avec honnêteté.
Le concept de « sentience » se démocratise de plus en plus. Comment le définis-tu et quelle est son importance dans la reconnaissance des droits des animaux ?
Contrairement au mot « sensibilité » qui est polysémique (on parle de la sensibilité d’objet comme les smartphones, ou de la sensibilité des plantes à la lumière), le mot « sentience » ne s’applique qu’aux animaux. Il définit leur capacité à vivre des expériences subjectives, à ressentir la douleur, le plaisir ou la souffrance et à éprouver des émotions positives ou négatives. Dans les pays anglo-saxons, il est utilisé depuis longtemps, mais n’est apparu dans le dictionnaire français qu’en 2020. Le site français de référence sur ce sujet est https://sentience.pm/.
La capacité à souffrir de façon consciente est reconnue chez de plus en plus d’espèces, comme l’affirment les scientifiques dans la déclaration de New York8. Ces scientifiques s’accordent sur l’existence de cette capacité chez tous les vertébrés, les crustacés décapodes et les céphalopodes et probablement chez bon nombre d’insectes car c’est une donnée scientifiquement évolutive au gré des recherches.
Les animaux sentients vivent leur vie en première personne, ont une histoire singulière, une personnalité et des intérêts. Cette capacité à ressentir la douleur ou le plaisir de manière subjective, c’est-à-dire en tant qu’individus, est un critère pertinent en éthique pour déterminer pour déterminer le traitement des animaux non humains, et serait pertinent pour déterminer des droits fondamentaux. C’est d’ailleurs intéressant de savoir que lorsque la réglementation européenne reconnaît les animaux comme des êtres sentients (sentient beings), la traduction française est “êtres sensibles”.
La terminologie de “sentience” ou “êtres sentients” n’apparaît donc pas encore dans la réglementation française. Cela a t-il une importance dans la reconnaissance de leurs droits ? Tous les juristes ne sont pas d’accord sur ce point. Personnellement, je ne pense pas que cela apporte grand-chose aux animaux : ils sont reconnus comme des êtres sensibles par la loi de Protection de la nature depuis 1976 (qui a créé l’article L214-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime), et par l’article 515-14 du Code Civil depuis 2015. Cela a-t-il opéré de grands changements dans leur traitement ? Malheureusement non, et je ne vois pas en quoi un changement de terminologie (d’êtres sensibles vers êtres sentients) fera avancer les choses. Dans les mouvements de justice sociale, le droit est très souvent en retard par rapport aux attentes citoyennes, et la cause animale ne fait pas exception.
Quelles seraient les premières mesures que tu mettrais en place à l’échelle nationale pour améliorer efficacement la condition animale ?
Déjà, je demanderais conseils à des personnes spécialistes des mécanismes économiques d’une part, et des mécanismes juridiques d’autre part, afin d’évaluer les impacts et la faisabilité des différentes mesures envisagées. En fonction de la faisabilité et de l’impact attendu, je priorise mes actions (désolée, déformation professionnelle de la consultante !). Il est en effet important de ne pas avoir une confiance aveugle en ses intuitions, car les impacts ne sont pas forcément là où on s’y attend le plus.
D’emblée, si j’ai carte blanche, je pense à ces mesures :
– Arrêt des subventions massives aux activités d’élevage et de pêche avec accompagnement à la transition des professionnel·les de ces secteurs
– Obligation d’inclure des clauses de bien-être animal dans les marchés publics (réécriture de l’article R2152-7 du Code de la Commande publique qui en prévoit aujourd’hui la possibilité)
– Octroi de droits pour les animaux (avec création d’une troisième catégorie dans le code civil)
– Formation obligatoire des forces de l’ordre, des magistrats sur la législation relative aux animaux pour en assurer son application
– Education réelle à l’éthique animale (pour les professionnel·les de l’éducation et les élèves) et au lien, avéré scientifiquement, entre les violences perpétrées sur les animaux et celles perpétrés sur les humains
– Nomination d’élu·es à la condition animale, à toutes les strates (ministres, différents échelons des collectivités territoriales)
– Création d’une sécurité sociale des animaux (financée par des taxes relatives à la consommation de produits d’origine animale, par exemple)
– Meilleure prise en compte des connaissances scientifiques par les décisionnaires politiques
– Valorisation des menus végétariens/végétaliens en restauration collective
– Soutien financier de l’Etat aux refuges et aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale (stérilisation des chats, prise en charge des animaux de publics fragiles, gestion éthique des pigeons, dispositifs d’accueil de la biodiversité, aide à la végétalisation des menus…)
– Garantie de la liberté d’information des lanceurs d’alerte (individus, associations)
– Régulation des lobbies
Y a-t-il un pays ou une culture que tu admires pour sa relation au vivant et aux animaux ?
A l’issue du tour du Monde que j’ai réalisé de 2017 à 2019, sur le thème de la protection animale, on m’a souvent posé cette question. Je ne réponds pas car en réalité, je ne suis restée qu’entre 1 et 3 mois dans chaque pays, la totalité de ces pays ne représentant qu’à peine 10% de tous les pays du monde. Je n’ai donc qu’une vision ultra-parcellaire et subjective de ceux-ci.
Je peux seulement témoigner de ce que j’ai vu : il y a, partout où je suis allée, des problématiques de cohabitation et de traitement des animaux, différentes selon les cultures, la géographie, l’histoire des lieux.
Pour notre propre relation aux vivants, ici et maintenant, j’ai personnellement une certaine facilité à m’imaginer une société zooinclusive, où les animaux sont considérés pour ce qu’ils sont : des individus ayant intérêt à vivre. Je n’ai pas besoin de m’inspirer de cultures lointaines et très différentes, car je sais que nous avons le pouvoir d’inventer de nouvelles manières de vivre, à partir de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons.
Quel message aimerais-tu transmettre à celles et ceux qui commencent à s’interroger sur leur rapport aux animaux, justement ?
Je leur dis déjà bravo pour ces interrogations, car tout le monde n’est pas prêt à se questionner sur le sujet ! Le triptyque “S’informer, se former, agir” est assez puissant, pour toutes les causes.
Aujourd’hui, de nombreuses ressources sont disponibles pour s’informer de la façon dont on souhaite.
Voici quelques références qualitatives, non exhaustives :
– “Les droits des animaux en question” (2022) de Dominic Hofbauer et Rosa B., une BD très bien écrite et dessinée, facile à lire et qui traite de droit mais aussi d’éthique animale.
– “Émancipation animale, Petit traité pour faire avancer les droits des animaux” (2022) de Charlotte Arnal, un excellent ouvrage qui pose les questions éthiques de nos relations avec les animaux sous l’angle juridique
– “Les animaux ont-ils des droits ?” (2022) de Florence Burgat, un ouvrage court qui fait à la fois un état des lieux de la condition animale, chiffres à l’appui, et qui met en perspective la prise en compte des animaux dans la législation
– Le site Questions animalistes, créé par Florence Dellerie qui est autrice et illustratrice scientifique. C’est une excellente vulgarisatrice, très rigoureuse, qui nous offre sur son site de nombreuses ressources et outils pour nous informer sur les sujets de l’esprit critique, de l’éthique animale, de la prise en compte des êtres sentients.
– Un livre court mais riche en contenus théoriques et aussi pratiques : “Manifeste animaliste, politiser la cause animale” (2017). Corine Pelluchon y explique les raisons pour lesquelles la cause animale est une cause universelle et peut/doit légitimement s’inscrire dans un projet de société global.
– Les livres “Introduction aux études animales” (2022) et “Considérer les animaux. Une approche zooinclusive” (2023) d’Emilie Dardenne, spécialiste d’études animales.
– “L’éthique animale – Que sais-je ?” (2018) de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
– Les BD “Les cerveaux de la ferme” (2021) et “Les paupières des poissons” (2018) de Sébastien Moro, vulgarisateur scientifique
– Les chaînes You Tube Cervelle d’oiseau de Sébastien Moro et Réplique éthique
– Le podcast “Comme un poisson dans l’eau” de Victor Duran Le Peuch : ce sont des interviews d’universitaires notamment qui travaillent sur le sujet des animaux. Les notions sont traitées en profondeur.
Pour se former, il existe aujourd’hui un nombre important de diplômes sur le sujet. En fonction des appétences et des sensibilités, on peut diriger vers les Diplômes Universitaires généralistes Animaux et société (Université de Rennes) et Études animales (université catholique de Lille). De nombreux Diplômes Universitaires en droit animalier existent aujourd’hui.
Gratuit et en ligne, le MOOC “Vivre avec les autres animaux” est disponible sur YouTube.
Je ne peux évidemment qu’encourager également à participer à une fresque des animaux (sessions en ligne régulièrement proposées), car c’est un formidable moyen de découvrir la transversalité et la complexité de la condition animale, en seulement 2h (version courte) ou 3h (version longue).
Enfin, j’inviterais à prendre le temps de découvrir les nombreuses associations qui œuvrent sur le sujet, et pourquoi pas s’engager pour l’une d’entre elles. Les problématiques sont tellement vastes que chacun·e peut trouver une façon de s’engager en mettant ses capacités au bénéfice de la cause. Ces engagements peuvent prendre des formes très variées : accueil d’animaux en situation difficile, aide à l’entretien de refuges, participation (physique ou virtuelle) à des campagnes, communication, création de contenus…
Sources :
1 https://www.researchgate.net/publication/323870923_Etes-vous_speciste
2 https://www.anses.fr/fr/content/regimes-vegetariens-effets-sur-la-sante-et-reperes-alimentaires
3 https://bonpote.com/albert-moukheiber-le-cerveau-est-instrumentalise-a-des-fins-ideologiques-ou-mercantiles/
4 https://observatoireduspecisme.ch/articles/test-bechdel-specisme-simba/
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide_food
6 http://evalou-editions.fr/10-tous-nos-livres
7 https://www.sei.org/perspectives/move-beyond-carbon-tunnel-vision/
8 https://lamorce.co/connaissez-vous-la-declaration-de-new-york-sur-la-conscience-animale/